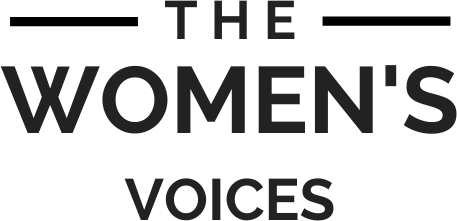Gestes obscènes, insultes, sifflements… Pour la première fois depuis la mise en place du dispositif en 2018, les outrages sexistes et sexuels ont diminué de 5% en 2024 en France, selon le ministère de l’Intérieur.
Une baisse de 5% historique, mais relative
Selon les données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), 3.200 outrages sexistes et sexuels ont été enregistrés en 2024, soit une baisse de 5% par rapport à 2023. Ce recul constitue une première depuis la mise en place du dispositif de verbalisation en 2018, après plusieurs années de hausse continue, dont un pic de +63% en 2021.
Ces infractions recouvrent des comportements tels que « remarques gênantes, gestes obscènes, insultes, sifflements… », précise le rapport. Elles visent très majoritairement les femmes, dans 90% des cas. Et les auteurs sont presque exclusivement des hommes : 97% selon les chiffres relevés en zone police.
Cette baisse peut être interprétée comme un signe positif, fruit des campagnes de sensibilisation, de la vigilance accrue des forces de l’ordre, et d’un début de prise de conscience sociétale. Mais la persistance des délits, leur gravité croissante et leur concentration dans certains espaces rappellent que le combat contre le sexisme de rue est loin d’être gagné.
Une justice plus sévère face aux récidives
La lecture des données révèle une évolution dans la qualification juridique des faits. Si les contraventions (infractions les moins graves) ont diminué de 11%, les délits – infractions aggravées par la récidive ou la circonstance – ont progressé de 15%. Aujourd’hui, plus d’un quart des outrages (26%) sont considérés comme des délits.
Selon la loi du 3 août 2018, l’outrage sexiste ou sexuel consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexiste ou sexuelle, qui porte atteinte à sa dignité ou qui l’expose à une situation intimidante, hostile ou offensante. « Depuis le 1er avril 2023, l’outrage sexiste ou sexuel aggravé n’est plus considéré comme une contravention mais comme un délit. Il est puni d’une amende de 3.750 euros », rappelle le SSMSI. À cette sanction peuvent s’ajouter des peines complémentaires, telles que le suivi d’un stage de citoyenneté ou des travaux d’intérêt général.
Une géographie de l’insécurité sexiste
L’agglomération parisienne demeure le territoire le plus exposé, avec huit outrages sexistes pour 100.000 habitants. Les grandes villes enregistrent également une prévalence élevée, avec cinq infractions pour 100.000 habitants. Ces chiffres, s’ils traduisent une meilleure visibilité de ces actes dans les zones densément peuplées, posent la question d’une insécurité sexiste systémique dans l’espace public urbain.
Les transports en commun constituent l’un des lieux les plus propices à la commission de ces infractions : « Toujours en zone police, 15% des infractions enregistrées ont été commises dans les transports en commun (métro, bus, tramway, train, autocar) ». Ces chiffres soulignent une réalité vécue quotidiennement par les femmes : la crainte, voire la certitude, de subir des comportements déplacés, dans des espaces clos et peu sécurisés.
Lire aussi : Il faut attendre 2075 pour que les femmes dirigent autant d’entreprises que les hommes, selon la Banque de France