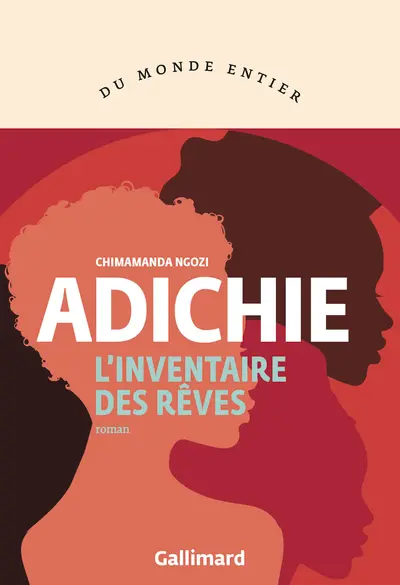Douze ans après son dernier roman, Chimamanda Ngozi Adichie signe un retour percutant avec L’inventaire des rêves, un récit choral qui explore les illusions, les choix et la sororité de quatre femmes entre le Nigeria et les États-Unis.
Rêver… mais pour qui ?
Avec L’inventaire des rêves, Chimamanda Ngozi Adichie interroge la légitimité des ambitions féminines dans un monde encore profondément inégalitaire. « Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si les rêves qu’une femme peut avoir sont vraiment les siens… Et dans quelle mesure la société les lui a dictés », confie l’autrice à l’AFP lors de son passage à Paris, à l’occasion de la sortie du roman chez Gallimard le 27 mars 2024.
À travers les parcours croisés de Chiamaka, Zikora, Omelogor et Kadiatou, Chimamanda Ngozi Adichie tisse une fresque intime sur les rêves et désillusions féminines. Chiamaka, écrivaine farouchement libre, rejette le mariage et défie les attentes de son entourage bourgeois resté au Nigeria. Zikora, mère célibataire, fait face à l’abandon du père de son enfant. Omelogor, femme d’affaires accomplie, abandonne tout pour retourner à l’université. Kadiatou, domestique immigrée, voit son rêve américain s’effondrer après une agression sexuelle.
Quatre héroïnes, une même lutte
Les protagonistes de Chimamanda Ngozi Adichie ne manquent pas de volonté, mais elles se heurtent à des injonctions sociales et culturelles puissantes. L’écrivaine nigériane souligne à quel point le monde juge plus durement les femmes ambitieuses ou indépendantes : « Elles sont jugées plus durement lorsqu’elles osent se montrer égoïstes, avoir de l’ambition. »
Et pourtant, dans la tempête, naît une sororité précieuse. « Les femmes sont élevées pour considérer les autres comme des rivales. Et quand une femme fait le choix d’aimer et soutenir une autre femme, c’est un acte de révolution », affirme l’autrice de Nous sommes tous des féministes. Ce manifeste, inspiré de sa conférence TED de 2012, a marqué les esprits, notamment après avoir été repris par Beyoncé dans son tube Flawless.
Une plume changée par la vie
À 47 ans, Chimamanda Ngozi Adichie revient après une longue pause d’écriture, marquée par le deuil de ses deux parents. Ce double traumatisme agit comme un déclencheur. « Ce livre est très différent de ce que j’ai fait avant, parce que je suis une personne différente. C’est mon premier roman en tant que mère, et en tant qu’orpheline », explique-t-elle. Plus libre dans son style, moins prudente dans sa langue, elle revendique une écriture transformée par l’expérience.
Élevée sur un campus universitaire au sud du Nigeria, dans un environnement intellectuel, elle partage désormais sa vie entre Lagos et le Maryland, aux États-Unis. Son roman précédent, Americanah (2013), a conquis un lectorat mondial. Aujourd’hui, elle revient en mettant au centre les contradictions de la vie et de l’identité féminine.
Contre l’uniformité du regard
Chimamanda Ngozi Adichie ne cesse de rappeler l’importance de multiplier les récits africains, loin des stéréotypes humanitaires. « L’Afrique continue à susciter de la pitié. Et on ne peut pas comprendre un pays comme le Nigeria […] avec les yeux de la pitié », insiste-t-elle. Pour elle, la culture occidentale a trop longtemps imposé une « histoire unique », réductrice, sur les pays africains.
Si elle regrette l’exil de milliers de jeunes Nigérians, elle n’accuse pas les rêveurs mais les dirigeants : « Le gouvernement se fiche d’améliorer la vie des gens ordinaires. C’est sa faute, pas celle de ceux qui ont des rêves. »