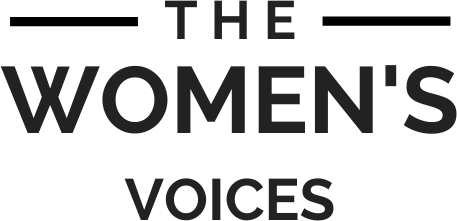Rare femme peintre admirée à travers l’Europe de son vivant, l’italienne Artemisia Gentileschi (1593-1656) fait l’objet d’une rétrospective inédite au musée Jacquemart-André à Paris. Cette exposition dresse le portrait de cette artiste dont l’œuvre a été marquée par un destin tragique.
Un parcours qui débute par une tragédie
L’exposition rassemble une quarantaine de tableaux et plusieurs dessins, dont certains ont été empruntés à des collections étrangères. Organisée par thèmes, elle retrace l’ascension de l’artiste, débutant à 16 ans dans l’atelier de son père, Orazio Gentileschi, à Rome. Progressivement, Artemisia s’émancipe sous l’influence du Caravage, dont le clair-obscur dramatique inspire ses compositions.
Son parcours est toutefois marqué par une épreuve terrible : à 17 ans, elle est violée par Agostino Tassi, un peintre et collègue de son père. S’ensuit un procès retentissant, documenté par des archives, durant lequel elle subit la torture pour prouver la véracité de son témoignage. « Elle a notamment les doigts broyés », rappelle Pierre Curie, commissaire de l’exposition aux côtés de Patrizia Cavazzini et Maria Cristina Terzaghi.
« Une remise à niveau » du statut artistique de Artemisia Gentileschi
Intitulée Artemisia, héroïne de l’art, cette rétrospective vise à reconsidérer l’importance de l’artiste, trop longtemps perçue comme « la fille de son père ». « On a découvert énormément de tableaux dans les dix dernières années, les attributions s’affinent et on comprend mieux sa place dans la diffusion du caravagisme », explique Pierre Curie. « La découverte de documents permet aussi de mieux comprendre la complexité de son parcours. »
Une représentation puissante des figures féminines
Artemisia Gentileschi excelle dans la représentation des figures féminines, associant maîtrise technique et souci du détail. Sa Vierge à l’Enfant est notamment exposée, montrant une mère nourrissant son enfant avec un réalisme saisissant. Ses toiles représentent souvent des héroïnes telles que Judith, Yaël, Lucrèce ou Cléopâtre, qu’elles soient vengeresses ou victimes.
« Rare femme peintre à représenter des femmes nues à son époque, Artemisia Gentileschi en accentue la sensualité – et la sienne dans ses autoportraits – par des postures et des scènes théâtrales », souligne l’un des commissaires. Ses scènes frappent par leur dramatisation : « Judith et sa servante » est présentée portant la tête d’Holopherne dans un panier, tandis que Yaël et Sisera capture l’instant précis où l’héroïne biblique s’apprête à tuer le général oppresseur.
Une carrière marquée par « versatilité et adaptabilité »
L’exposition débute par des commandes royales, notamment celles passées par les cours de France et d’Angleterre. Artemisia a participé à l’achèvement du plafond de la Maison de la Reine à Greenwich, entre 1638 et 1640, aux côtés de son père.
« Elle part du modèle de son père et adopte le caravagisme, avant de se lier aux artistes napolitains et d’adopter aussi leur style, dans une sorte de versatilité et d’adaptabilité qui sont peut-être une résilience », analyse Pierre Curie.
Sa carrière florissante la conduit à travailler pour de grands mécènes, des Médicis au roi d’Espagne, jusqu’à tomber dans l’oubli, comme le caravagisme, dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
Une femme peintre exceptionnelle
L’exposition présente également une série de petits portraits dessinés à Rome en 1620, où Artemisia figure déguisée en homme, affublée d’une moustache. Femme artiste dans un milieu dominé par les hommes, elle s’impose grâce à son talent et sa volonté.
Mariée un temps, elle eut plusieurs enfants mais seule une fille survivra. Après avoir vécu à Rome et à Florence, elle s’installe à Venise (1626-1629), puis à Naples (1630-1638), avant un passage à Londres (1638-1640). Elle y travaille pour Charles Ier d’Angleterre, avant de retourner à Naples, où elle s’éteint vers 1656, probablement victime de la peste.
L’exposition Artemisia, héroïne de l’art offre une occasion unique de redécouvrir cette femme peintre exceptionnelle, dont l’héritage pictural et la résilience continuent d’inspirer.
Lire aussi : The Infinite Woman : une exposition sur la déconstruction de la vision féminine traditionnelle